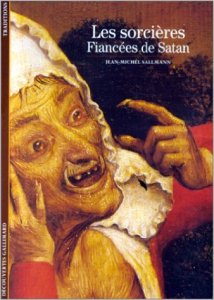Lire Primo Levi, c’est rentrer avec lui dans le Lager. C’est suivre un homme qui n’est jamais réellement sorti de ce camp d’Auschwitz/Monowitz où il passe environ un an alors qu’il a 24 ans, déporté d’Italie. Son dernier livre, sous-titré « Quarante ans après Auschwitz », commence par une passionnante étude des travers et des risques de la mémoire, changeant avec le temps, se figeant ou s’altérant pour supporter l’infini de douleur et de mal du vécu concentrationnaire. Qu’elle soit celle des bourreaux ou celle des victimes, Levi prend soin de prévenir les ruses de la mémoire pour finalement justifier l’oeuvre que lui entreprend, oeuvre du souvenir et tentative de compréhension, lui qui est resté toujours inquiet de ce que les événements atroces auxquels il a été confronté ne se reproduisent. Comme le chimiste qu’il fut, sa quête est celle du chercheur qui étudie et questionne, aussi profondément qu’il le peut, les réactions et phénomènes « naturels » qui ont mené l’humanité à un tel abîme. Analysant différents problèmes de la vie du camp, et ceux que les survivants portent avec eux du seul fait qu’ils ont survécu (la communication, la honte, la confrontation à l’ignorance ou aux stéréotypes), Primo Levi écrit en scientifique, prudemment, intelligemment: son intégrité et sa probité, l’honnêteté qui vient à celui qui se sait ignorant devant la complexité des êtres et du monde en remontrent aux tenants des discours faciles. Pour autant, ces lignes respirent un courage, une ténacité, une obstination même: ne pas laisser s’évaporer, ne pas laisser disparaître les traces de ce grand naufrage de la civilisation européenne moderne. C’est l’appel d’une conscience malheureuse et désillusionnée mais extrêmement forte en même temps. Pleine de cette sorte unique de courage qui est celui des désespérés et qui rappelle Camus. Primo Levi sombrera finalement peu après la parution de cette oeuvre testamentaire mais la force de son témoignage demeurera à jamais dans ces pages.
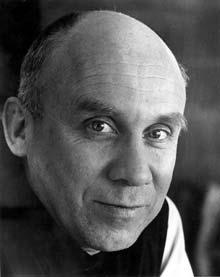 La nuit privée d’étoiles est le titre français de l’autobiographie écrite par Thomas Merton en 1948 (il a alors 33 ans), à la demande de son supérieur dans le monastère trappiste où il est entré quelques années plus tôt. Beau titre, poétique: sans le comprendre tout à fait, je le lie à tout ce qui dans ce texte se rapporte aux nombreuses « défaillances » que Merton se voit, ses aveuglements, ses contradictions, ses vanités comme autant d’ombres ajoutées à l’ombre du monde.
La nuit privée d’étoiles est le titre français de l’autobiographie écrite par Thomas Merton en 1948 (il a alors 33 ans), à la demande de son supérieur dans le monastère trappiste où il est entré quelques années plus tôt. Beau titre, poétique: sans le comprendre tout à fait, je le lie à tout ce qui dans ce texte se rapporte aux nombreuses « défaillances » que Merton se voit, ses aveuglements, ses contradictions, ses vanités comme autant d’ombres ajoutées à l’ombre du monde. J’aime cette façon de lire l’Ecriture, active, fine et profonde. Il y a chez lui un véritable « acte » de lecture qui implique de laisser tomber ses a priori, son prêt-à-penser, de renoncer à savoir avant de lire. L’un de ses sujets de prédilection est celui de la famille, peut-être (dans le champ catholique tout au moins) l’un des plus encombrés de certitudes, d’évidences et de facilités. Dans cet ouvrage, au langage simple et… familier, celui d’une conversation plutôt que d’un traité, il bouscule l’air de rien la plupart des idées un peu trop fixes concernant la famille: qu’est-ce qu’être père ou mère selon la Bible? homme et femme? frère ou soeur? qu’en est-il au juste de cette sacro-sainte institution, qu’on dit malmenée de toutes parts, quand à la lecture des histoires familiales de la Bible on ne voit nulle part ni modèles de vertu, ni… modèle tout court. Le patriarche Jacob trompeur et trompé dans ses tractations patrimoniales puis matrimoniales, Isaac le « fils du rire » de Dieu qui inscrit son histoire sainte dans les impasses des histoires humaines, le « messie » David lui-même, mal-aimé par sa femme Mikal, la fille de Saül, devenu manipulateur sans vergogne pour obtenir celle que ses yeux ont admiré, Bethsabée la mère de son fils et successeur Salomon. A partir de ces exemples choisis, et nombreux, de récits bibliques qui démontent toute tentation de récupération moralisante, Philippe Lefebvre tire presque toujours des fils (double signification autorisée ici) jusqu’à l’avènement du Christ Jésus dans une famille elle aussi hors-normes. Cette lecture englobante de l' »un et l’autre Testament » faite sans simplisme, sans raccourcis, m’offre à chaque fois l’occasion d’un « renouvellement de l’intelligence » et la chance d’une célébration de cette Ecriture si chatoyante et bigarrée, lieu elle-même des noces entre Dieu et l’humain.
J’aime cette façon de lire l’Ecriture, active, fine et profonde. Il y a chez lui un véritable « acte » de lecture qui implique de laisser tomber ses a priori, son prêt-à-penser, de renoncer à savoir avant de lire. L’un de ses sujets de prédilection est celui de la famille, peut-être (dans le champ catholique tout au moins) l’un des plus encombrés de certitudes, d’évidences et de facilités. Dans cet ouvrage, au langage simple et… familier, celui d’une conversation plutôt que d’un traité, il bouscule l’air de rien la plupart des idées un peu trop fixes concernant la famille: qu’est-ce qu’être père ou mère selon la Bible? homme et femme? frère ou soeur? qu’en est-il au juste de cette sacro-sainte institution, qu’on dit malmenée de toutes parts, quand à la lecture des histoires familiales de la Bible on ne voit nulle part ni modèles de vertu, ni… modèle tout court. Le patriarche Jacob trompeur et trompé dans ses tractations patrimoniales puis matrimoniales, Isaac le « fils du rire » de Dieu qui inscrit son histoire sainte dans les impasses des histoires humaines, le « messie » David lui-même, mal-aimé par sa femme Mikal, la fille de Saül, devenu manipulateur sans vergogne pour obtenir celle que ses yeux ont admiré, Bethsabée la mère de son fils et successeur Salomon. A partir de ces exemples choisis, et nombreux, de récits bibliques qui démontent toute tentation de récupération moralisante, Philippe Lefebvre tire presque toujours des fils (double signification autorisée ici) jusqu’à l’avènement du Christ Jésus dans une famille elle aussi hors-normes. Cette lecture englobante de l' »un et l’autre Testament » faite sans simplisme, sans raccourcis, m’offre à chaque fois l’occasion d’un « renouvellement de l’intelligence » et la chance d’une célébration de cette Ecriture si chatoyante et bigarrée, lieu elle-même des noces entre Dieu et l’humain.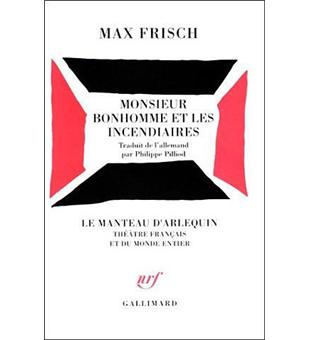 Pièce écrite en 1958, la même année où il reçoit le Büchnerpreis, M. Bonhomme et les incendiaires est une « pièce didactique sans doctrine » comme la décrit Frisch en sous-titre. Qu’a-t-elle à nous apprendre? Peut-être veut-elle nous apprendre à apprendre justement… à saisir les signes et les bruits de la fureur et du chaos. Mais sans doctrine bien sûr… Charge féroce et drolatique sur l’aveuglement et la surdité d’un certain monde bourgeois, ou de tout monde bourgeois (c’est-à-dire de tout « intérieur » où ne compte que la préservation d’un certain ordre), la pièce se déroule accompagnée du parodique choeur des pompiers, valeureux et impuissants gardiens de la cité. La référence à la tragédie antique joue en plein dans l’effet d’une certaine fatalité qui entraîne incendiaires et incendiés vers la destruction. L’épilogue de la pièce est magistral: on y retrouve les protagonistes dans une scène d’au-delà où l’enfer s’éteint au ciel parce que l’enfer est sur terre et où se retournent (enfin) tous les faux-semblants de la justice, de la bonté et du salut.
Pièce écrite en 1958, la même année où il reçoit le Büchnerpreis, M. Bonhomme et les incendiaires est une « pièce didactique sans doctrine » comme la décrit Frisch en sous-titre. Qu’a-t-elle à nous apprendre? Peut-être veut-elle nous apprendre à apprendre justement… à saisir les signes et les bruits de la fureur et du chaos. Mais sans doctrine bien sûr… Charge féroce et drolatique sur l’aveuglement et la surdité d’un certain monde bourgeois, ou de tout monde bourgeois (c’est-à-dire de tout « intérieur » où ne compte que la préservation d’un certain ordre), la pièce se déroule accompagnée du parodique choeur des pompiers, valeureux et impuissants gardiens de la cité. La référence à la tragédie antique joue en plein dans l’effet d’une certaine fatalité qui entraîne incendiaires et incendiés vers la destruction. L’épilogue de la pièce est magistral: on y retrouve les protagonistes dans une scène d’au-delà où l’enfer s’éteint au ciel parce que l’enfer est sur terre et où se retournent (enfin) tous les faux-semblants de la justice, de la bonté et du salut. Moby Dick terminé (après plusieurs mois eu égard à son volume), une pensée me vient: « probablement le plus grand roman qu’il m’ait été donné de lire ». Je partage cette hypothèse avec mon épouse et à sa question « ah et pourquoi? », je me rends compte que je n’ai pas de réponse claire à donner… Il est habituel de penser que cela se produit toujours face à ce que l’on aime le plus: l’impression que les mots que l’on trouve pour en parler sont tous insuffisants pour décrire l’émotion et l’admiration que l’on ressent. Oui, il y a sans doute cela, le sentiment que devant une telle oeuvre on ne peut que s’incliner, admirer, adorer peut-être… Se taire et vouloir d’une certaine façon que tout s’arrête devant l’événement de cette chose découverte. C’est ce type de sentiment qui nous prend sur un fameux pic ou sur une farouche côte. Le sentiment d’une immensité implacable, le sentiment « océanique » peut-être dont parlait Romain Rolland…
Moby Dick terminé (après plusieurs mois eu égard à son volume), une pensée me vient: « probablement le plus grand roman qu’il m’ait été donné de lire ». Je partage cette hypothèse avec mon épouse et à sa question « ah et pourquoi? », je me rends compte que je n’ai pas de réponse claire à donner… Il est habituel de penser que cela se produit toujours face à ce que l’on aime le plus: l’impression que les mots que l’on trouve pour en parler sont tous insuffisants pour décrire l’émotion et l’admiration que l’on ressent. Oui, il y a sans doute cela, le sentiment que devant une telle oeuvre on ne peut que s’incliner, admirer, adorer peut-être… Se taire et vouloir d’une certaine façon que tout s’arrête devant l’événement de cette chose découverte. C’est ce type de sentiment qui nous prend sur un fameux pic ou sur une farouche côte. Le sentiment d’une immensité implacable, le sentiment « océanique » peut-être dont parlait Romain Rolland…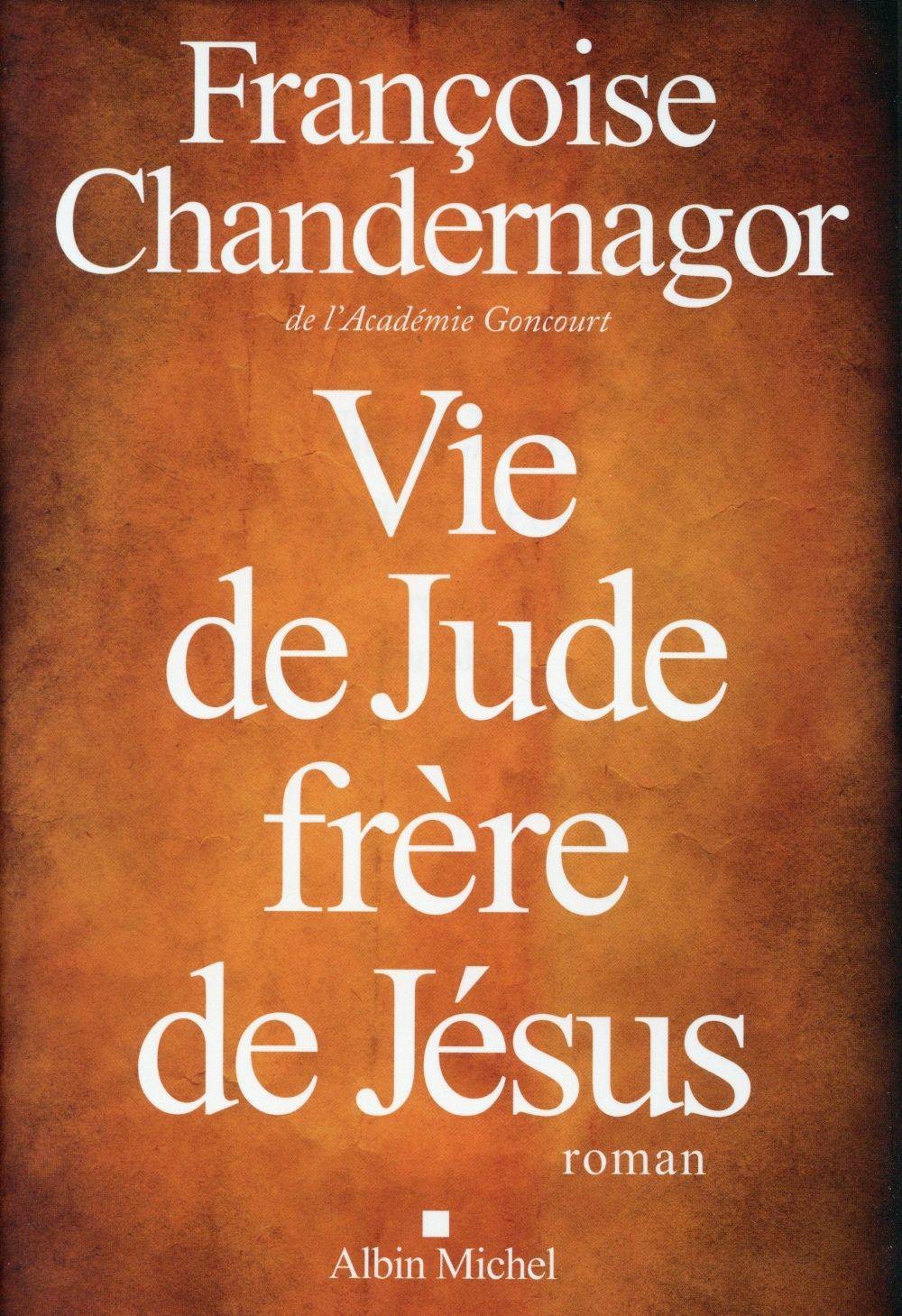 Nous voilà entrés avec la « reine » des romans historiques dans la peau de Jude, un frère de sang de Jésus, nommé par les auteurs de deux des Evangiles canoniques (Mt 13,55 et Mc 6,3). Qui est-il? Rien ne permet de le dire, comme d’ailleurs les recherches historiques sur Jésus qui n’ont peut-être au final que consolidé le mystère de cet homme devenu Dieu, renforcé encore un peu plus l’étonnement de cette transformation. Mais par cette plume habile qu’il est plaisant d’écouter cette langue juive (imaginée mais plausible) du 1er siècle, truffée de résonances bibliques, de se laisser gagner par l’urgence eschatologique qui était en effet vibrante dans les esprits des premiers chrétiens, de sentir l’affection fraternelle qui faisait de la première Eglise judéo-galiléenne une famille. Ce Jude est attachant, il parle de ce frère aîné qui lui échappe en même temps qu’il l’attire irrésistiblement, avoue ses doutes, ses peurs et son dépit de voir déjà les premiers frères se diviser. J’aime ici me détendre dans l’idée qu’un roman peut dire aussi vrai que l’histoire, exprimer une vérité du sentiment et de l’expérience qu’aucune étude strictement historique ne saura laisser échapper. Les Evangiles ne sont rien d’autre que ces regards croisés sur la figure d’un Jésus devenu Christ et même Luc qui veut faire oeuvre d’historien de la première Eglise ne le fait qu’à partir d’une expérience autant historique (au sens de chronique, inscrite dans le temps) qu’an-historique, dépassant tout conditionnement temporel et instaurant une autre histoire dirait-on, l' »histoire sainte », faite du déroulement de la vie divine dans les cadres de la vie humaine.
Nous voilà entrés avec la « reine » des romans historiques dans la peau de Jude, un frère de sang de Jésus, nommé par les auteurs de deux des Evangiles canoniques (Mt 13,55 et Mc 6,3). Qui est-il? Rien ne permet de le dire, comme d’ailleurs les recherches historiques sur Jésus qui n’ont peut-être au final que consolidé le mystère de cet homme devenu Dieu, renforcé encore un peu plus l’étonnement de cette transformation. Mais par cette plume habile qu’il est plaisant d’écouter cette langue juive (imaginée mais plausible) du 1er siècle, truffée de résonances bibliques, de se laisser gagner par l’urgence eschatologique qui était en effet vibrante dans les esprits des premiers chrétiens, de sentir l’affection fraternelle qui faisait de la première Eglise judéo-galiléenne une famille. Ce Jude est attachant, il parle de ce frère aîné qui lui échappe en même temps qu’il l’attire irrésistiblement, avoue ses doutes, ses peurs et son dépit de voir déjà les premiers frères se diviser. J’aime ici me détendre dans l’idée qu’un roman peut dire aussi vrai que l’histoire, exprimer une vérité du sentiment et de l’expérience qu’aucune étude strictement historique ne saura laisser échapper. Les Evangiles ne sont rien d’autre que ces regards croisés sur la figure d’un Jésus devenu Christ et même Luc qui veut faire oeuvre d’historien de la première Eglise ne le fait qu’à partir d’une expérience autant historique (au sens de chronique, inscrite dans le temps) qu’an-historique, dépassant tout conditionnement temporel et instaurant une autre histoire dirait-on, l' »histoire sainte », faite du déroulement de la vie divine dans les cadres de la vie humaine.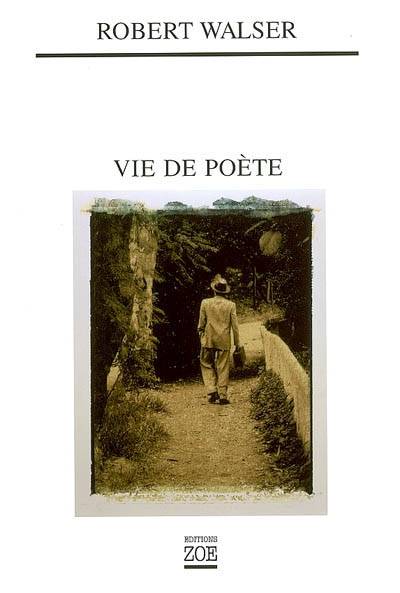 On est comme dans un rêve dans les courts récits de Walser (des « proses » comme il les appelait). Comme entraînés dans un courant, un flot d’images et de sensations où notre volonté et notre intelligence sont comme laissées en déshérence. Tout arrive comme par enchantement, tout disparaît tout aussi bien. Et le rêveur éveillé passe plus loin. Une impression d’une sorte de « laisser-aller » dans l’écriture (l’expression du « laisser vivre » qu’il revendique aussi dans le dernier texte de Vie de poète ? ) qui me semble en fait extrêmement travaillé. Le plus grand effort en vue d’en laisser paraître le moindre. Cela peut-être pour tenter, à sa façon unique, d’approcher une sorte d’accord, de correspondance entre l’intérieur et l’extérieur, les mouvements d’une âme et ceux, pour le dire d’un mot, de la « vie » : soit le grand rêve romantique.
On est comme dans un rêve dans les courts récits de Walser (des « proses » comme il les appelait). Comme entraînés dans un courant, un flot d’images et de sensations où notre volonté et notre intelligence sont comme laissées en déshérence. Tout arrive comme par enchantement, tout disparaît tout aussi bien. Et le rêveur éveillé passe plus loin. Une impression d’une sorte de « laisser-aller » dans l’écriture (l’expression du « laisser vivre » qu’il revendique aussi dans le dernier texte de Vie de poète ? ) qui me semble en fait extrêmement travaillé. Le plus grand effort en vue d’en laisser paraître le moindre. Cela peut-être pour tenter, à sa façon unique, d’approcher une sorte d’accord, de correspondance entre l’intérieur et l’extérieur, les mouvements d’une âme et ceux, pour le dire d’un mot, de la « vie » : soit le grand rêve romantique.